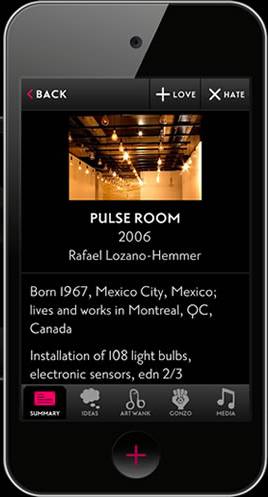Éclipse Australie du 14 novembre 2012
(partie 6)
Wim Delvoye nous regarde
faire la queue au Mona (nous sommes à
quelques km au nord de Hobart, Tasmanie).


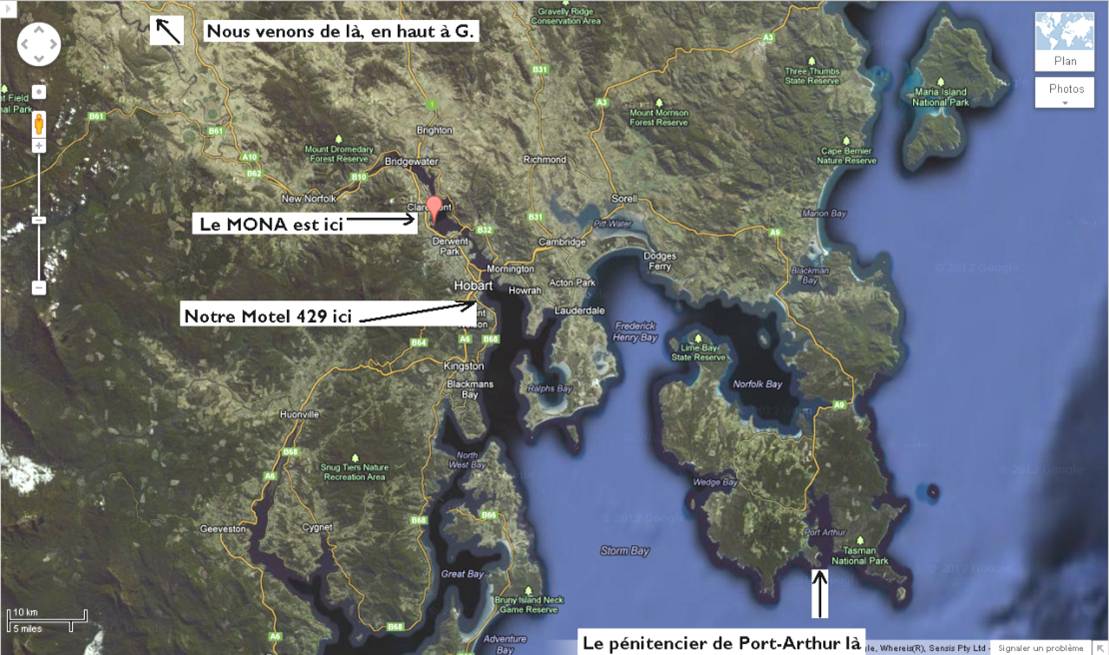
Quel choc, ce musée. Voici
le papier de Guy Duplat
qui m’a donné envie d’y aller voir.
Celui-ci,
dans le numéro d’ArtPress d’avril 2011 m’a scié
(format Word).
Et celui du journaliste suisse Luc Debraine que je viens de découvrir, est passionnant :
Le musée des
extrêmes (mis en ligne le 27 septembre 2011)
En
Tasmanie, le collectionneur David Walsh a ouvert le MONA, extraordinaire musée
d’art qui pose la question du futur de ce type d’institution. Son bras droit
est un jeune Genevois, Olivier Varenne.
« Le
bord du monde» : voilà comment les Tasmaniens décrivent leur île, fichée
au sud de l’Australie. Au-delà de cette terre extraordinaire, grande comme une
fois et demie la Suisse, plus d’espoir de civilisation : rien que de
l’océan glacial, des manchots, peut-être quelques baleines. Or, ce bord du
monde s’est enrichi il y a peu d’un musée lui aussi extrême : le MONA,
comme Museum of Old and New
Art.
Extrême
par son parti pris esthétique, centré sur la mort, le sexe, la religion et les
mythes. Extrême par son dédain des chronologies, des catégories, des normes,
des points de vue univoques sur l’art. Surtout extrême par sa témérité.
Comme si
le vieux genre du musée, né à la Renaissance avec le cabinet de curiosités, trouvait
ici, sur cette île-ponctuation du monde, son expression ultime. En revenant
précisément à l’idée de cabinet de curiosités, avec une Wunderkammer du XXIe
siècle qui s’étend, sous terre, sur 6000 m2.
 David Walsh
David Walsh
L’acronyme
MONA s’inspire de celui du MoMA, le Musée d’art
moderne de New York. Ce qui tombe bien : pour Glenn Lowry, directeur de
l’institution new-yorkaise, les musées doivent changer. Leurs visiteurs
découvrent de plus en plus l’art en ligne, sur les sites des musées ou
ailleurs, ce qui contraindra bientôt ces institutions à revoir la manière dont
elles présentent leurs collections.
Elles
devront proposer une autre expérience esthétique, encourageant les amateurs d’art
à se déplacer pour les visiter. L’autre point soulevé par Glenn Lowry est celui
de la globalisation : l’art est aujourd’hui partout, et il vient de
partout. Les musées doivent s’adapter à cette nouvelle donne mondialisée,
polyphonique, combinatoire.
En
Tasmanie, le MONA pousse à bout cette exigence de réinvention. Il encourage les
amateurs d’art à s’aventurer loin, très loin de chez eux. Et il enchevêtre la
création la plus archaïque à la plus contemporaine, que celle-ci vienne
d’Australie, des Cyclades, du Pérou, de Paris ou de Lausanne.
Jamais le
MONA n’aurait eu cette liberté s’il avait été créé par une institution
officielle. Mais il est l’œuvre d’un seul homme, un collectionneur australien
qui est aussi mécène, joueur professionnel, mathématicien borderline,
viticulteur – certainement l’une des personnalités les plus étonnantes que l’on
puisse rencontrer de Reykjavik à Hobart, la capitale de l’État australien de
Tasmanie.
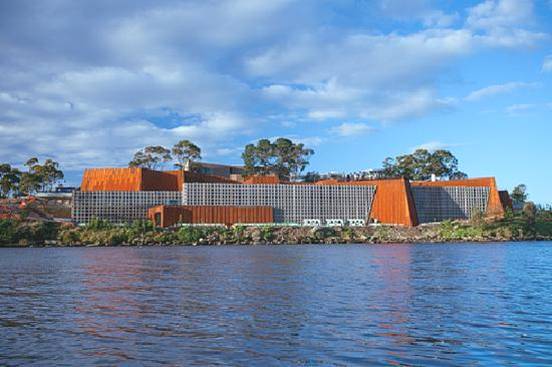
David
Walsh, né il y a cinquante ans à Hobart, a été élevé par une mère seule, dans
le dénuement. L’adolescent solitaire, que l’on dirait aujourd’hui atteint du
syndrome d’Asperger, forme légère d’autisme, se découvre une passion pour le
temps long de l’histoire. Le seul musée gratuit – il l’est toujours – de Hobart
est le TMAG,
le Musée d’art et d’histoire de Tasmanie. David Walsh y passe des heures,
autant qu’il s’immerge dans la littérature et les mathématiques.
À
l’université, avant d’être renvoyé pour piratage informatique, le jeune homme
et quelques amis, qui sont toujours ses partenaires en affaires, trouve un
filon d’argent frais. Au casino de Hobart. David Walsh tire profit de ses
aptitudes hors normes en calcul de probabilité pour gagner de grosses sommes au
blackjack. L’équipe rafle ensuite des
martingales dans des casinos du monde entier.
Avec un
problème à la clé : comment faire pour sortir une fortune d’un pays, alors
que la législation de celui-ci l’interdit ? David Walsh a l’idée d’acheter
des œuvres d’art sur place, qu’il exportera ensuite en Tasmanie. Sa première
acquisition est, en Afrique du Sud, une ancienne porte de palace sculptée, bel
exemple d’art yoruba qui sera la pièce fondatrice de sa collection.

Il y a une
quinzaine d’années, David Walsh, désormais multimillionnaire, acquiert une
propriété viticole à une dizaine de kilomètres de Hobart, au bord du fleuve
Derwent. Le domaine Moorilla (« Le rocher près
de la rivière » en langue aborigène) comprend une demeure que David Walsh
transforme en musée. Devenu aussi numismate, il y expose de précieuses
collections de pièces de monnaie antique et d’autres œuvres d’art moderne ou
contemporain.
Comme
David Walsh ne se donne pas la peine de promouvoir son musée, personne ne le
visite. Ce qui donne à cet esprit provocateur l’idée de construire un musée
encore plus grand. D’autant que le collectionneur a entre-temps acquis une
œuvre monumentale de l’artiste australien Sidney Nolan : Snake, une
peinture longue de 46 mètres. C’est décidé : le nouveau musée se
construira autour de cette pièce inspirée du temps du rêve des Aborigènes.
David
Walsh fait appel à un architecte de Melbourne, Nonda Katsalidis, d’origine grecque. Plutôt que d’ériger un
bâtiment en hauteur, telle une construction exubérante à la Frank Gehry, dont David Walsh a horreur, la paire décide
d’aménager un musée dans les profondeurs du grès jaune qui borde le fleuve.
Ce parti
pris souterrain obéit à une conviction du mécène : l’art ne doit pas nous
être imposé d’en haut, de manière autoritaire, mais d’en bas, par étapes
successives. David Walsh croit dans l’acquisition gradualiste de la
connaissance, en trouvant peu à peu ce qu’on ne cherchait pas a priori.

Le MONA
est un labyrinthe qui se déploie sur trois niveaux reliés entre eux par un
escalier à la Escher. L’on s’y perd à dessein, comme
dans le Musée juif de l’architecte Daniel Libeskind à
Berlin. La structure est gigantesque, caverneuse, menaçante, fascinante
surtout. Dante s’y serait plu. Pour un visiteur non prévenu, l’entrée du MONA
est invisible. Elle est aménagée dans l’une des anciennes maisons du domaine, à
côté d’un court de tennis.
L’accès se
fait aussi par la rivière, au terme d’un trajet de quarante-cinq minutes depuis
le port de Hobart. C’est alors qu’apparaît la seule partie visible en surface
du musée: une large façade aveugle ponctuée d’acier rougeoyant et d’eucalyptus.
Un restaurant, une vinothèque-brasserie, une librairie et de confortables
pavillons pour loger les visiteurs – ils accueillent chacun des pièces de la
collection de David Walsh – complètent l’aménagement de Moorilla.
Le domaine
est jalonné d’œuvres d’art. Comme l’installation de l’artiste alémanique Roman
Signer sur le parking : une Rover détruite après avoir trop forcé son
passage entre deux murs de béton. De grandes vitrines, qui évoquent des iPhone géants,
s’allument la nuit venue au passage des visiteurs : elles contiennent
aussi bien de l’art précolombien que des pièces romaines, des vidéos ou des
peintures aborigènes.

Aucune œuvre,
dans le MONA, n’est décrite. Là encore, David Walsh l’iconoclaste se méfie des
explications réductrices : « Les musées nous infligent leur propre
point de vue sur leurs œuvres. Ce regard est un peu celui du monothéisme, de
l’autorité suprême. Comme s’il n’y avait qu’un seul point de distribution du
savoir... C’est tout le contraire. En plus, nous sommes dans l’ère de la perte
d’influence de la figure de l’expert, grâce à l’internet. Wikipedia
est l’un des grands achèvements de nos démocraties, justement parce que cette
encyclopédie confronte les points de vue. Si nos visiteurs veulent en savoir
plus sur un artiste, ils peuvent s’informer sur l’internet. Aujourd’hui, nous
sommes tous des recherchistes. »
Le
visiteur du MONA peut toutefois prendre à l’entrée un baladeur numérique qui,
par repérage automatique des lieux, lui donnera des explications sur les œuvres
exposées. Un commentaire sur un bronze romain ou une installation contemporaine
peut varier d’appareil en appareil, ce qui doit, là encore, encourager à la
confrontation des points de vue.
David
Walsh insiste tellement sur ce point qu’il a demandé à un collectif d’artistes
autrichiens, Gelitin, de modifier les toilettes
situées près du bar, à l’entrée du musée. Si le visiteur s’assoit sur le trône,
un jeu de miroirs lui renvoie – en face de lui – l’image de son anus. Une
manière radicale de changer de perspective, de découvrir ce qui est caché,
voire refoulé. Nom de l’œuvre : Locus
Focus.
Et si
l’art a pour fonction de rendre visible l’invisible, y compris les excrétions
de notre propre corps, le MONA joue cartes sur table. Dans une pièce créée
expressément pour cet automate, une machine-cloaque de l’artiste belge Wim Delvoye fabrique de la merde, de la vraie, avec force
vapeurs malodorantes. Le musée de David Walsh est ainsi : il alterne la
fange ironique de Delvoye et la grâce d’une statuette
d’Isis, les ruines d’Anselm Kiefer et les vidéos en
apesanteur de Bill Viola.
 Anselm Kiefer
Anselm Kiefer
Ici-bas,
pas de hiérarchies, ni de catégories : toutes époques confondues, les
œuvres se répondent les unes aux autres. Dans une salle encore plus enténébrée
que les autres, au terme d’un chemin de dalles qui affleurent à la surface d’un
bassin, un sarcophage égyptien dialogue en silence avec une image de la série The Morgue du photographe Andres Serrano. On pense aux « Longs échos qui de loin se
confondent » de Baudelaire.
David Walsh
a même parié sur la disparition de Christian Boltanski. Dans un pacte faustien,
le mécène australien a acheté en viager la vie de l’artiste français. Jusqu’à
la mort de Boltanski, des caméras disposées dans l’atelier parisien de
l’artiste transmettent en direct, 24 heures sur 24, leurs images au MONA, sur
des écrans disposés dans un pavillon spécial. Nom de l’œuvre: The life of C. B.
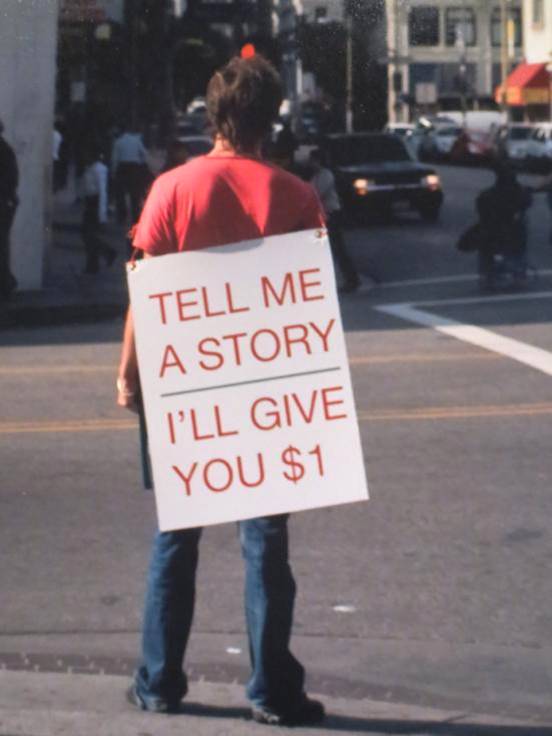 James Newitt
James Newitt
Le bras
droit de David Walsh est le Genevois Olivier Varenne, 34 ans. Ce curateur
indépendant parcourt les capitales de l’art à la recherche de talents pour le
collectionneur des antipodes. Il a fait entrer au MONA les œuvres de plusieurs
créateurs suisses : Roman Signer, Thomas Hirschhorn,
Alain Huck, Léopold Rabus
ou Jonathan Delachaux.
Olivier
Varenne a participé à l’organisation de l’exposition inaugurale, Monanism
(contraction sarcastique de « MONA » et d’« onanisme »),
une sélection de 460 pièces de la collection de David Walsh. Celle-ci en compte
au total quatre fois plus, pour une valeur de 100 millions de dollars
australiens.
La
construction du musée en a coûté autant. Ouvert en janvier dernier, le MONA a
déjà accueilli 250 000 personnes, dont 10% en provenance du monde entier. Durée
moyenne de la visite : quatre heures. Personne en Australie n’aurait
prédit un tel score, sauf David Walsh. L’expert en probabilités avait fixé le
seuil de 300 000 entrées au bout d’une année d’ouverture. Comme toujours, il
gagnera son pari.
 Michel Blazy
Michel Blazy
En
décembre, la prochaine exposition d’Olivier Varenne au MONA sera une
rétrospective Wim Delvoye. Dont Tim, un modèle bien vivant
qui porte un tatouage de l’artiste flamand sur le dos et s’expose comme une
œuvre d’art. Jean-Hubert Martin,
l’ancien directeur de la Kunsthalle de Berne et du
Centre Pompidou, est désormais lui aussi un proche collaborateur du MONA.
Il puisera
dans les réserves du TMAG,
le musée d’art et d’histoire de Hobart, pour mettre sur pied l’an prochain une
autre exposition temporaire. Un hommage au lieu – gratuit – où toute l’aventure
a commencé.
-----------
(c) L’Hebdo
... lequel TMAG
l’on trouvera ici,
avec la suite du voyage.
(pour d’autres images du MONA, cliquer là)
P.-S.
L’audioguide génialissime du
MONA – et sa touche « Artwanks », entre
autres, figurée par une bite ! (juste au-dessus du signe +, tout en bas).
En haut le « plus » blanc et le
« fois » vous permettent de « liker »
ou « disliker » les œuvres devant
lesquelles vous vous trouvez (lesquelles l’audioguide
retrouve grâce à son GPS embarqué).